

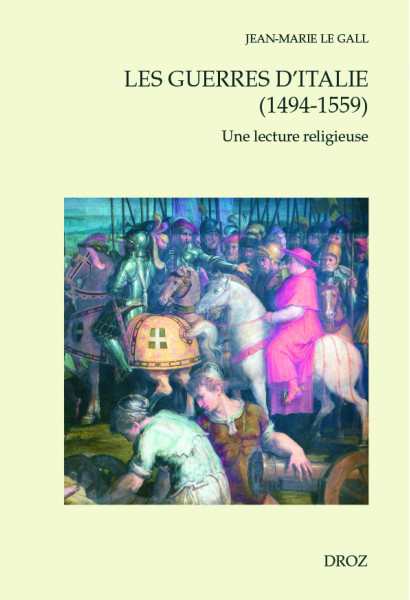
Reviewer Jean-Louis Fournel - Université Paris 8
CitationOn ne peut que se réjouir, dans un panorama critique où les travaux sur les guerres d’Italie – surtout en France – ne sont pas légion, de voir publié un ouvrage qui leur soit consacré, d’autant qu’il est écrit par un historien qui a procuré récemment une étude de référence sur la bataille de Pavie (L’honneur perdu de François 1er. Pavie 1525, Paris, Payot, 2015) et coordonné un intéressant ouvrage collectif sur La défaite à la Renaissance (Genève, Droz, 2015). Il est tout aussi utile d’aborder ce moment historique à la lumière de la question religieuse. Il faudrait en effet être frappé d’un coupable aveuglement pour contester l’intérêt d’une telle approche en des temps qui voient se succéder la Florence savonarolienne, le concile du Latran, les débuts de la réforme luthérienne, le sac de Rome par les lansquenets allemands puis les premiers conflits d’ordre (au moins pour partie) religieux dans l’Europe septentrionale et un exil important de lettrés, d’imprimeurs ou de capitaines en odeur d’hérésie vers le nord du continent, sans même parler du plus important des conciles de l’âge moderne – le concile de Trente (1545-1563) – et des débats spirituels qui l’ont précédé, débats marqués “l’évangélisme” selon une terminologie qui prête à discussion. Il n’est pas non plus dénué de pertinence de rappeler qu’un des angles d’analyse privilégié du XVIe siècle, au moins dans la tradition française, est l’articulation (à partir des notions de continuité, tournant, rupture ou seuils) entre ce que l’historiographie française a nommé “les guerres d’Italie” et ce qui a été qualifié de “guerres de religion” (quelle que soit par ailleurs la critique de cette qualification pour certains qui préfèrent parler de “guerres civiles” pour ces conflits armés que les contemporains baptisèrent le plus fréquemment, quant à eux, de “troubles”).
La question n’est donc pas de savoir si oui ou non une “lecture religieuse” est pertinente pour parler des guerres d’Italie: elle l’est indéniablement. Et d’ailleurs le contenu des quatre chapitres – servis par une écriture enlevée, tendue, voire parfois gourmande – le démontre abondamment avec une rédaction tout à la fois claire et savante, fourmillant d’illustrations pertinentes du propos et nourrie par une synthèse efficace. Ainsi sont présentés au lecteur tour à tour “le temps des espérances” (centré autour de la question de la prophétie apocalyptique et de son statut dans ces temps de bouleversement et de faillite d’une certaine rationalité), “l’affirmation de la monarchie pontificale” (suivant une lecture largement fondée sur la thèse de Paolo Prodi dans son ouvrage majeur, Il Sovrano pontefice), les “hétérodoxes italiens” (avec une discussion des analyses de l’école de Delio Cantimori) et les “violences militaires” liées à la “religion” (avec le déploiement d’une position nuancée sur l’importance du facteur religieux sans pour autant défendre en l’occurrence une monocausalité).
Reste donc à considérer quelle est la façon heuristiquement la plus féconde d’aborder cette affaire. Or, au-delà de la richesse érudite des données convoquées, de l’allant d’une écriture polémique – qui laisse filtrer un certain goût provocateur – et de l’efficacité d’un propos suffisamment ramassé pour être clair, on peut relever toutefois une sorte de faille entre la pertinence de nombre de considérations ponctuelles et le cadre interprétatif dans lequel celles-ci sont inscrites. L’assez longue introduction de l’auteur avance une proposition précise et circonstanciée sur laquelle on se doit de revenir car elle constitue manifestement la justification de l’ouvrage: cette “lecture religieuse” des guerres d’Italie entend remettre en question ce qui est considéré ici comme un paradigme dominant de la lecture de la première modernité puisque d’emblée il est écrit (pp. 12-13) que “la lecture exclusivement politique de ces conflits … tient beaucoup à l’emprise intellectuelle et canonique que Machiavel et Guichardin, deux illustres contemporains, continuent d’exercer sur nous, comme l’atteste la floraison de commentaires et d’exégèses de leurs œuvres”. L’auteur tient suffisamment à cette analyse sans nuance pour la reprendre de façon encore plus militante en conclusion: “ce livre a voulu laisser place à une autre lecture que celle qui s’est imposée à partir de Guichardin et qui semble se répéter et se commenter à l’infini, dans une sorte de piété toute religieuse envers l’un des pères de la politique moderne”. Assez curieusement, cette “emprise” se mesurerait donc à l’aune du nombre des “exégèses” actuelles sur les deux auteurs sans que l’on ne prenne la peine de remarquer que (hélas!) la plupart des nombreuses lectures machiavéliennes (lectures à vrai dire pas si nombreuses, en revanche, pour ce qui est de Guichardin …[1]) ne mettent que très rarement les textes des deux Florentins en perspective par rapport à l’état de guerre permanent. En outre, et surtout, il est bien malaisé d’établir une barrière étanche entre le “politique” et le “religieux”, dans les œuvres des deux Florentins et plus généralement dans toute la pensée politique de ce temps-là. Guichardin ne choisit-il pas de placer en ouverture de son livre de Ricordi un “avertissement” soulignant que la foi peut déplacer des montagnes? Machiavel ne consacre-t-il pas aux principats ecclésiastiques un chapitre du Prince, ne confère-t-il pas à Numa un statut tout à fait exceptionnel dans les Discours, n’appelle-t-il pas dans un passage fondamental à “leggere la Bibbia sensatamente” (à savoir “lire la Bible en lui donnant tout son sens” – Discours III, 30 – une considération dont on perçoit l’importance pour une réflexion sur la violence religieuse) et ne fait-il pas de la religion civique bien autre chose qu’un vulgaire instrument ? Il est au passage assez largement admis que la formulation d’une religio instrumentum regni constitue (à l’enseigne de cet autre lieu commun pseudo-machiavélien selon lequel “la fin justifie les moyens”) une obsession des chantres de l’anti-machiavélisme plus qu’un pilier de la pensée de Machiavel[2]. On est donc bien loin de ce qui est posé sans doute un peu hâtivement dans certains passages de l’ouvrage traité ici – et qui, de façon assez intéressante, est démenti à d’autres moments de ce même livre grâce à une argumentation plus sophistiquée, par exemple sur la question de l’anti-cléricalisme italien, sur les saintes ligues ou sur le passage du concile de potentiel levier de l’opposition aux papes à arme des pontifes[3].
On a du coup parfois l’impression que l’auteur construit un adversaire épistémologique et idéologique qui n’existe plus vraiment (voire, parfois, qui n’a jamais existé) et fonce à bride abattue contre des moulins qui ne méritent pas une telle ardeur : la “sécularisation” et la myopie “moderniste” qu’il dénonce sont depuis longtemps de vieilles lunes sur lesquelles la critique est largement revenue (vieilles lunes burckhardiennes si l’on veut mais d’un Burckhardt mal lu et mal compris). Bien peu nombreux sont ceux qui songent aujourd’hui à nier l’importance du fait religieux, ou la place des “inquiétudes” et de la “rénovation” spirituelles, dans la dynamique des guerres. A la condition toutefois de pointer qu’il est malaisé de percevoir une autonomie radicale de ce fait religieux et que l’Eglise catholique peut à l’occasion donner des exemples bien peu spirituels de pratiques politiques et de stratégies familiales (ce qui est dit dans le livre à cet égard de la modernité supposée du népotisme pontifical peut à bon droit laisser perplexe le lecteur). De même, l’opposition entre sphère laïque et sphère religieuse qui est prêtée dans l’ouvrage à la majorité de la critique historique sur les guerres d’Italie relève pour partie d’une confusion entre l’ensemble de la critique et ce qui n’en constitue qu’un pan – au vrai de plus en plus dépassé et restreint. Ainsi, il convient de tenir compte par exemple du fait que, en dehors d’une lignée anglo-américaine, tout ce qui tourne autour de ce que Hans Baron a appelé l’“humanisme civique” n’est plus le socle de la plupart des interprétations des liens entre guerre et politique à la Renaissance.
Pour se convaincre de la nécessité de complexifier certaines de ces propositions on se contentera de pointer le cas du “moment savonarolien”[4]. L’idée même de l’existence d’un “moment savonarolien”, dans un dialogue critique avec la notion de “moment machiavélien” au cœur du grand livre de John Pocock (tardivement traduit en français …), est là pour illustrer une certaine évolution de la critique sur l’histoire de la pensée politique italienne et sur son articulation avec l’histoire des guerres d’Italie. On ne saurait à ce propos régler la question en reprenant la catégorie usée – et parfaitement déplacée en l’occurrence – de “théocratie” et encore moins en supposant une sorte d’étrangeté de Savonarole aux questions politiques et institutionnelles (les sermons sur Aggée de novembre à décembre 1494 eurent, on le sait, un rôle crucial dans la naissance de la nouvelle république du Grand Conseil …). La critique savonarolienne aujourd’hui est bien loin de se contenter de voir dans ce case study soit une préfiguration du Risorgimento soit l’illustration des mésaventures d’un prophète désarmé, selon ce qu’énonce Jean-Marie Le Gall. Savonarole et son verbe contribuent pleinement à l’émergence de cette langue nouvelle de la politique qui, de fait, voit le jour au cours des guerres d’Italie (dans ce cas une certaine attention philologique à la lettre des textes peut s’avérer utile) tout en laissant une place à la religion. A cet égard les travaux récents sur Botero et la raison d’état ne sont en rien une illustration de l’écartement de la religion mais tout au contraire la démonstration de la capacité de la Curie romaine à construire un contre-discours romain face à la souveraineté bodinienne, la raison d’Etat allant de pair avec l’édification explicite d’une “raison d‘Eglise”, comme l’ont bien montré les travaux de Romain Descendre.
Peu importe à vrai dire l’étiage du “moderne” dans cette affaire et l’on peut tomber d’accord avec l’auteur sur les excès du lexique de la modernité dans certaines études sur les guerres d’Italie. On pourra aussi accorder que la notion de “pré-moderne” – préférée par certains aujourd’hui à celle de “Renaissance” – présente autant de faiblesses que la catégorie qu’elle entend remplacer. Doit-on pour autant courir le risque de jeter le bébé avec l’eau du bain, user d’une supposée opposition entre le religieux et le politique pour soutenir implicitement l’hétérogénéité de ces deux champs (alors que les exemples donnés démontrent le contraire), ou se fonder sur un supposé écartement du second au profit du premier pour en déduire que rien de nouveau ne se passe dans ces guerres d’Italie? Rappelons-nous les mots du jeune Guichardin – encore une fois – dans ses Storie fiorentine selon lequel “avec Charles [Charles VIII] entra en Italie une flamme une peste qui non seulement changea les Etats mais les façons de les gouverner et les façons de faire la guerre”.
[1] Jusqu’à la fin des années 1990, Guichardin était bien loin d’être omniprésent dans l’historiographie française sur les guerres d’Italie. Certes le neveu de Colbert avait pu inciter (BNF manuscrits Clérembault, Clair 519, Projet d’estude, fo 329) les futurs diplomates français à “commencer par lire Guichardin” dans son projet d’une école d’ambassadeurs au XVIIe siècle, mais c’est peu de dire qu’aux XIXe et XXe siècle il avait été somme toute assez peu entendu, comme le montre les vicissitudes des publications de Guichardin en français de 1840 à 1996!
[2] Les travaux d’Emanuele Cutinelli-Rendina (notamment Chiesa e religione in Machiavelli, Pisa, Ist. Editoriali e Poligrafici, 1998) auraient pu à cet égard être d’une certaine utilité, de même que certaines des entrées de la récente et monumentale Enciclopedia Machiavelli (Roma, Treccani, 2014).
[3] On remarquera que Jean-Marie Le Gall cite d’ailleurs à l’occasion des passages de Guichardin qui ne vont pas dans le sens de son introduction.
[4] Il convient en effet de prendre en compte notamment les contributions qu’a suscitées naguère le “centenaire” (à partir de 1994 et jusqu’au début des années 2000), lesquelles sont loin de se limiter aux livres de Lorenzo Polizzotto ou de Stefano Dall’Aglio, beaucoup cités dans le présent ouvrage mais dont l’importance tient d’abord à l’analyse de l’héritage savonarolien plus qu’à celui de la Florence savonarolienne stricto sensu. Qu’il suffise ici de rappeler les travaux d’Armando Verde ou de Giancarlo Garfagnini qui autorisent des lectures plus nuancées de ce moment (plus généralement la bibliographie italienne foisonnante sur la question mériterait d’être mieux prise en compte).